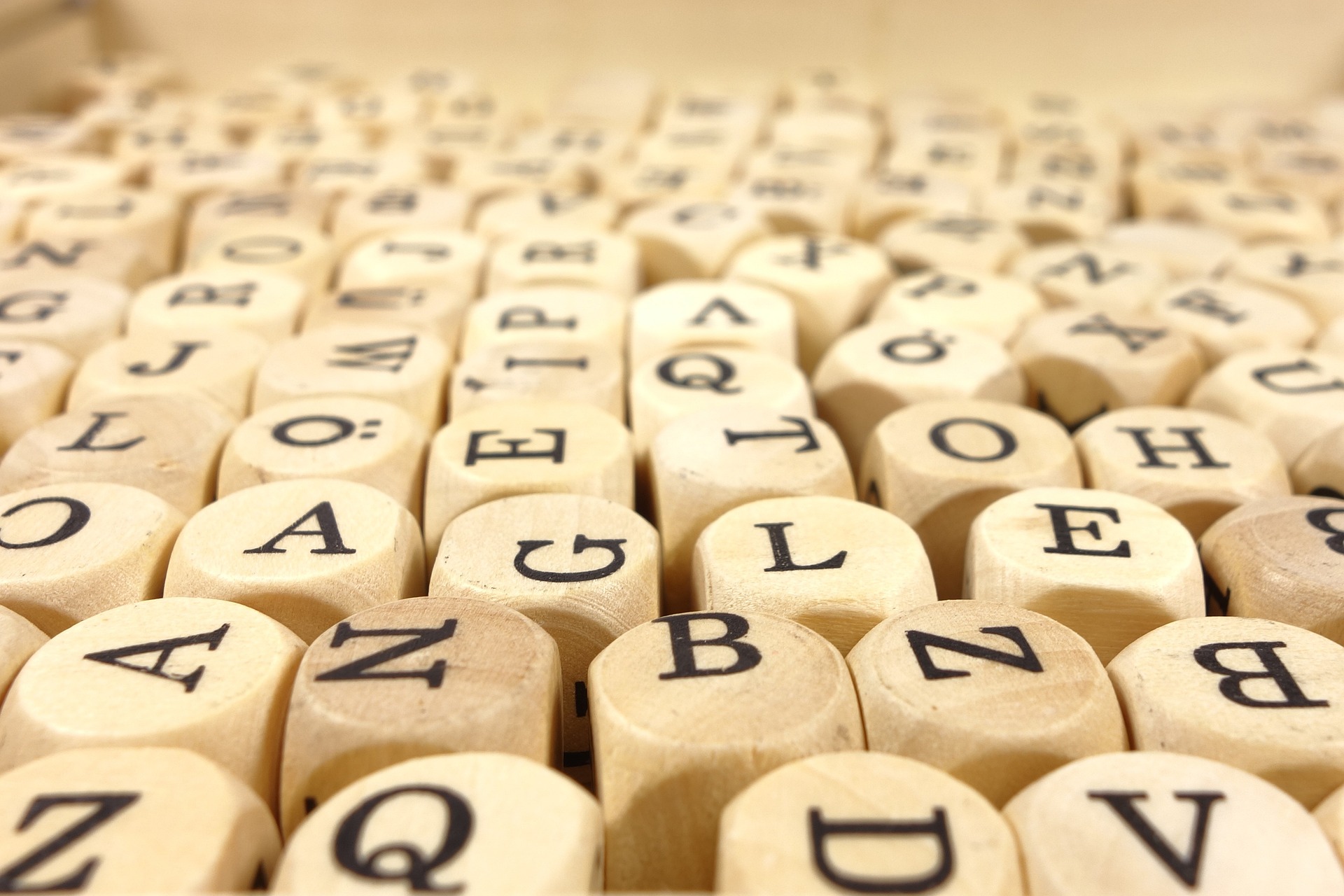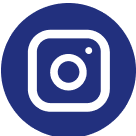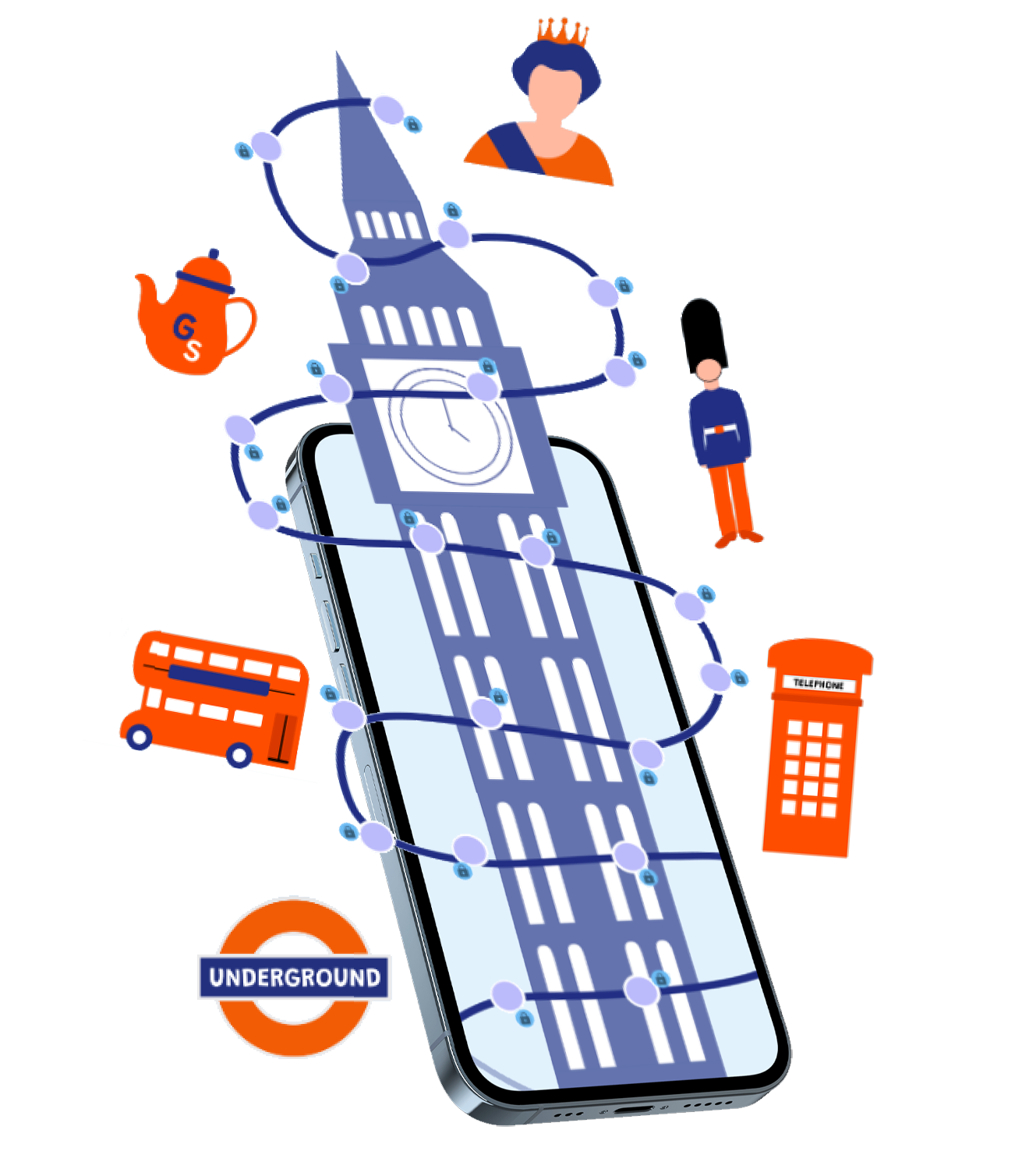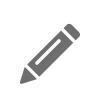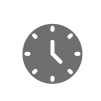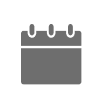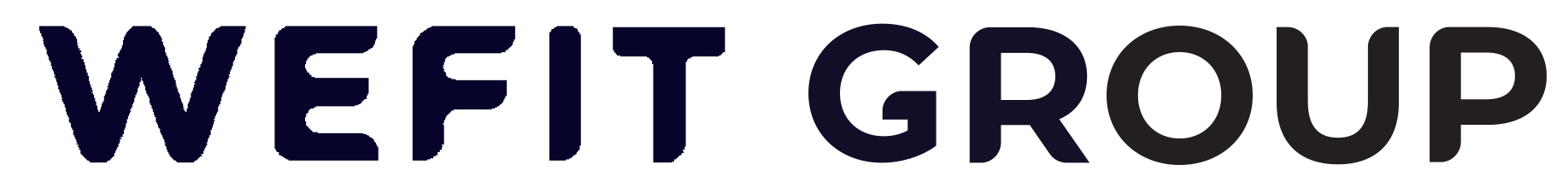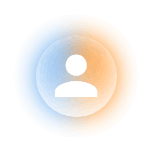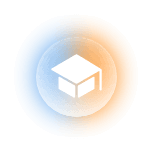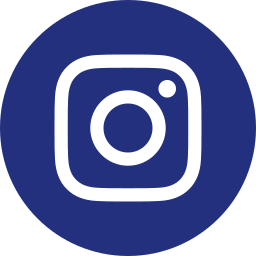Crée toi un don pour les langues avec Globe Speaker
Apprends une nouvelle langue en t’amusant avec la méthode révolutionnaire Globe Speaker.







Ce n’est sans aucun doute pas le fruit du hasard si l’on dit de l’Inde qu’elle serait le pays aux 330 millions de dieux.
Transmise par d’immenses et nombreux récits traditionnels, la mythologie indienne est fascinante sur plus d’un aspect ; un sentiment que nous allons vous partager à travers un petit tour d’horizon des divinités indiennes les plus « fondatrices » si l’on peut dire.
Quelques repères
Avant de présenter individuellement les divinités les plus populaires du paysage mythologique hindou, il est important d’apporter quelques éléments de repères chronologiques et généalogiques, étant donné le caractère légèrement complexe et divers des récits traditionnels.
Des premiers Vedas, dont ont peut dater l’origine au XVe siècle avant notre ère (figurant à ce titre parmi les textes littéraires les plus anciens de l’histoire de l’humanité), jusqu’aux derniers Puradas, dont on suppose que la rédaction daterait entre le IVe et XVe siècle de notre ère, les récits se chevauchent et apportent de siècle en siècle des éléments biographiques sur les divinités, en plus d’explications cosmogoniques sur l’origine et le destin du monde. Néanmoins, à mesure que l’on passe du védisme à l’hindouisme, l’ensemble des dieux du panthéon védique sont progressivement supplantés par ce que l’on appelle la Trimurti hindoue, qui compte trois dieux : Brahma, créateur du cosmos ; Shiva, le destructeur ; et Vishnu, le conservateur de l’univers.
Le Panthéon védique
Selon le Rig Veda (un des quatre grands textes canoniques de l’hindouisme : la somme de ces textes porte le nom de Veda), il y a trente-trois dieux védiques ; onze habitant le ciel, onze dans les eaux, et onze sur terre. Ils sont conçus comme des êtres personnels, se déplacent dans des chars brillants, mangent, boivent, mais n’ont jamais besoin de dormir. Ils travaillent et l’on obtient leur amitié que difficilement. Les Dieux védiques représentent les forces naturelles, mais ils ne sont pas que cela (en partie en raison du fait que la distinction entre ce qui est naturel et non naturel n’est pas très nette).
- Dans ce Panthéon, figure en premier lieu Varuna, symbole du paradis, souverain et magicien. Il règne sur le monde, les dieux, et sur les hommes. Son regard se porte sur les occupations de tous, il lit les pensées les plus secrètes et surveille toute activité.

- On peut ensuite citer Purusha, l’être primordial, le maître de l’immortalité. Purusha est l’être même, pris en toute temporalité : il est le monde déjà passé, le monde tel qu’il est en cet instant, mais aussi l’avenir. Il est en même temps indissociable de l’énergie qui se développe dans le monde.

- Sans doute le plus ancien des dieux, Kama est le dieu de l’amour. C’est la personnification du désir, du plaisir sensuel et surtout du plaisir sexuel. Son action détermine parmi les êtres la loi du samsara, la suite continue et infinie des naissances et des morts. Vous vous êtes peut-être un jour, demandez quelle était la source d’inspiration du Kamasutra, le fameux recueil « d’aphorismes du désir », et d’illustrations de certaines positions intimes ? Vous avez la réponse !

La Trimurti Hindoue
Ce qui caractérise l’hindouisme, postérieur au védisme, est une dévalorisation progressive du panthéon védique : les soustractions et ajouts s’accompagnent d’une montée phénoménale de deux anciennes divinités, Vishnu et Shiva. Les trois dieux qui composent la Trimurti hindoue sont, chacun dans des lieux différents, considérées comme des divinités suprêmes. D’interminables épopées racontent leurs aventures et celles de leurs descendances. Ces récits constituent les Puranas, Mahabharatas, et Ramayanas.
- Brahma, notamment, est l’incommensurable et le seigneur de toutes les créatures. Il est considéré comme un créateur, directeur du ciel, maître des horizons et des quatre Vedas. Les hindous le placent généralement au-dessus et au-delà de tout culte et de toute dévotion.

- Shiva, le feu créateur, est vraisemblablement hérité de la figure de Rudra dans le Panthéon védique, mais ces deux figures ne se limitent pas à une simple filiation ; au contraire, elles sont les faces complémentaires et indissociables d’une même divinité. Shiva est bienfaisant, créateur ; Rudra est destructeur. Cette unité forme une figure de dieu souverain, organisateur du monde.

- Enfin, Vishnu termine cette trinité qui compose la Triumurtie hindoue, source de la religion hindoue. Vishnu est ainsi un des grands dieux de l’Inde, et la cause de l’existence. Il est le garant de la stabilité du monde, et possède mille noms et propriétés. Il est partout et pénètre tout ; il est en ce sens le sauveur, le protecteur, l’ami qui se met du côté des hommes, tandis que Shiva est le maître.

Crée toi un don pour les langues avec Globe Speaker
Apprends une nouvelle langue en t’amusant avec la méthode révolutionnaire Globe Speaker.







Articles similaires